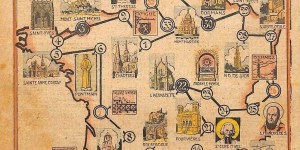"Plus vite !", dit la devise olympique. "Moins vite !", prêchent pourtant quelques voix dans le même désert que celles qui appellent à la décroissance. Parmi elles, Thierry Gouvenou, pourtant co-organisateur des plus grandes courses cyclistes du monde : "Aujourd’hui, on n’a pas d’autre priorité que de réduire la vitesse." A-t-on bien lu ? La remarque prend place dans une enquête passionnante, publiée dans le numéro de juin de Vélo Magazine (il faut bien changer ses références de temps en temps, il n’y a pas que Claudel et Bernanos dans la vie). L’article s’intitule "En finir avec ce jeu de massacre" et il se penche sur les chutes de plus en plus fréquentes qui marquent les courses cyclistes. Le journaliste évoque notamment la "scène de chaos" de la quatrième étape du Tour du Pays basque, où trois des "quatre fantastiques" du Tour de France qui vient de s’achever ont chuté : "Roglic déambule hagard, Evenepoel sort du bois, debout, un bras en écharpe pendant que Vingegaard fait l’objet de tous les soins de la part de deux médecins secouristes accourus en urgence, prêts à le conduire dans l’ambulance après la pose d’un corset." On sait que ces trois-là se sont relevés, mais d’autres restent sur le carreau.
Le cyclisme, miroir de la société
Ce qui rend l’enquête passionnante est de constater à quel point le cyclisme professionnel est un miroir de la société. Toutes les questions soulevées par le journaliste excèdent le domaine sportif et pourraient être au cœur d’une campagne électorale : réseau routier, bien sûr, mais aussi innovations technologiques, société du spectacle, enjeux financiers, manque d’éducation des jeunes coureurs, possibilité ou non de revenir en arrière..., tout y passe. À l’heure où certains appellent de leur vœu un Premier ministre issu de la société civile, on se demande si le directeur du Tour de France ne serait pas l’homme le plus en phase avec les problèmes de la société actuelle. Même son prénom et son nom, Christian Prudhomme, pourraient être mis en avant. Ils juxtaposent l’héritage du christianisme, le chevalier médiéval, le bourgeois du XIXe et la défense juridique de l’employé exploité. Qui dit mieux pour un patronyme inclusif ?
Contentons-nous d’un mot sur le rapprochement des progrès des hommes et des progrès du matériel.
À Thierry Gouvenou, qui signale qu’on ne lance pas des Formule 1 sur des routes traditionnelles, le technicien d’une marque célèbre rétorque qu’on ne bride pas une voiture de luxe : "Il faut continuer à faire rêver les gens en faisant avancer la technologie. Tout va plus vite, les hommes comme le matériel. Ça fait partie de l’évolution inévitable du sport-business. Et le sport-business, on en tire bénéfice nous aussi." Passons sur le capitalisme brutal ("Ça rapporte, donc ça ne peut être discuté"). Contentons-nous d’un mot sur le rapprochement des progrès des hommes et des progrès du matériel. Dans l’ordre de la vitesse, cela semble incontestable, du moins si on veut justifier sans soupçon que Pogacar aille encore plus vite que le surdopé-surdrogué Pantani. Sur le Tour de France, les motards signalent qu’ils n’ont plus de marge de manœuvre dans les descentes, à côté de cyclistes qui vont à 100 à l’heure (ce n’est désormais plus une expression, mais une donnée établie).
Le progrès contre l’homme
Machines et hommes progressent en vitesse, soit. Dans son judicieux Une question de taille (Stock, 2014), toutefois, Olivier Rey a rappelé que le progrès ne pouvait exister dans l’absolu ; il devrait toujours dépendre du but que l’homme s’est fixé. Comparant le vélo et la voiture, il remarquait que si l’enjeu était de réduire le temps de trajet jusqu’au lieu de travail, le vélo avait apporté un progrès bien plus net, avec pourtant une technologie moins poussée. Dans le cas des cyclistes professionnels, l’enquête de Vélo Magazine ne peut occulter une vérité fâcheuse : le progrès technologique est devenu une régression pour l’homme ; il ne marche pas avec l’homme, mais contre l’homme. Le danger accru des courses, apprend-on, ne vient pas seulement des freins à disque qui créent un sentiment d’impunité ou des guidons de plus en plus étroits qui réduisent la résistance de l’air. Il vient aussi d’une emprise technologique qui fait perdre au cycliste ses propres capacités de vigilance. D’où cette conclusion qui n’est signée ni par Heidegger ni par Jacques Ellul, mais par un journaliste sportif amoureux du Tour de France : "Au même titre que les oreillettes, les compteurs GPS et capteurs de puissance ont altéré le libre-arbitre, l’instinct et la concentration du coureur." Verra-t-on un jour un cycliste foncer dans un mur parce que le GPS ne lui a pas dit qu’il y avait un obstacle?
La technologie ou le rêve
"Continuer à faire rêver les gens en faisant évoluer la technologie ?" Qu’ils soient cyclistes du dimanche ayant sué pour ne pas mettre le pied au sol dans la montée du Puy Mary ou buveurs de pastis bedonnant, les spectateurs sont prêts à admirer tous les coureurs du Tour de France, jusqu’au dernier du classement et sa lanterne rouge. Il importe peu que l’étape soit bouclée à une moyenne de 38 kilomètres par heure au lieu de 40 (plus de 46 pour le dernier Milan-San Remo), du moment qu’il y a lutte, échappées solitaires, retournements de situations, grimaces de douleur et sourire de vainqueur. En revanche, quand un champion ne se distingue plus guère de sa machine et qu’il n’est moins prévisible qu’elle que quand il chute lourdement, la technologie ne suscite pas le rêve, elle le tue.